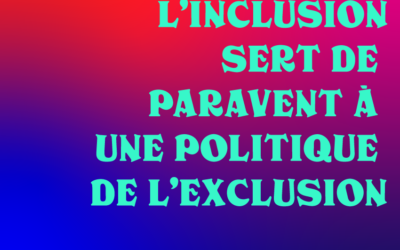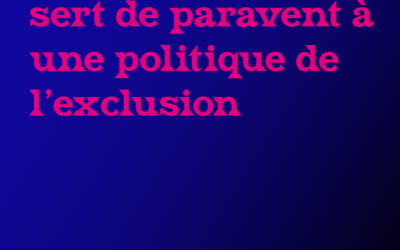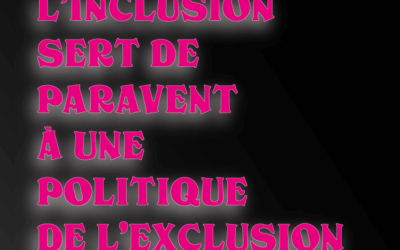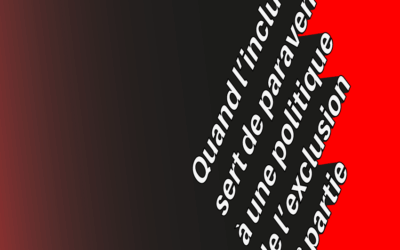Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion
Retrouvez ci-dessous les articles parus dans l’Educateur de novembre 2024 à janvier 2026.
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion | 14e partie
L’inclusion confisquée : l’écart structurel entre discours et pratiques managériales
Pour comprendre pourquoi l’inclusion proclamée demeure une fiction, il faut interroger la configuration du champ scolaire, au sens où Bourdieu l’entendait : un espace traversé par des rapports de force et des hiérarchies symboliques, où les principes officiels se heurtent aux logiques pratiques de leur mise en œuvre. L’injonction à l’inclusion y opère comme norme légitime, mais dans un cadre organisationnel qui en neutralise la portée.
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion | 13e partie
La rencontre avec la CIIP : anatomie d’un renversement accusatoire
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion : 12e partie
Résister et inventer : la promesse d’un commencement.
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion | 11e partie
« Résister et inventer : retrouver la puissance d’agir dans un monde néolibéral »
Pour qui accepte de se décaler un instant et consent à quitter l’enceinte scolaire, il apparait avec évidence que les phénomènes mis en lumière dans cette série consacrée à l’école inclusive — en particulier ce durcissement technocratique qui capte notre force de travail et entrave toujours davantage notre puissance d’agir — débordent largement le seul périmètre institutionnel du DIP et de la CIIP, de Genève, de la Suisse romande, et excèdent même les frontières nationales et européennes.
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion | 10e partie
Les outils de surveillance et l’intensification de la domination
À l’heure où l’école publique est soumise à une mise sous tutelle managériale qui confisque l’autonomie enseignante et dissout les collectifs éducatifs, la SPG affirme la nécessité d’un renversement politique clair.
Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion | 9e partie
Alors que l’école publique est soumise à une déstabilisation systémique sous couvert d’efficience et de modernisation, l’analyse syndicale met en lumière la réalité d’une dépossession professionnelle organisée. Derrière les logiques managériales imposées par le DIP c’est un véritable processus de désinstitutionnalisation qui s’enclenche : verticalisation autoritaire, hiérarchies déresponsabilisées, dilution des collectifs éducatifs. La directive sur le temps de travail des enseignant illustre la mise sous tutelle de l’autonomie enseignante par le renforcement de directions d’établissement sans légitimité pédagogique, outillées davantage pour contrôler que pour soutenir.